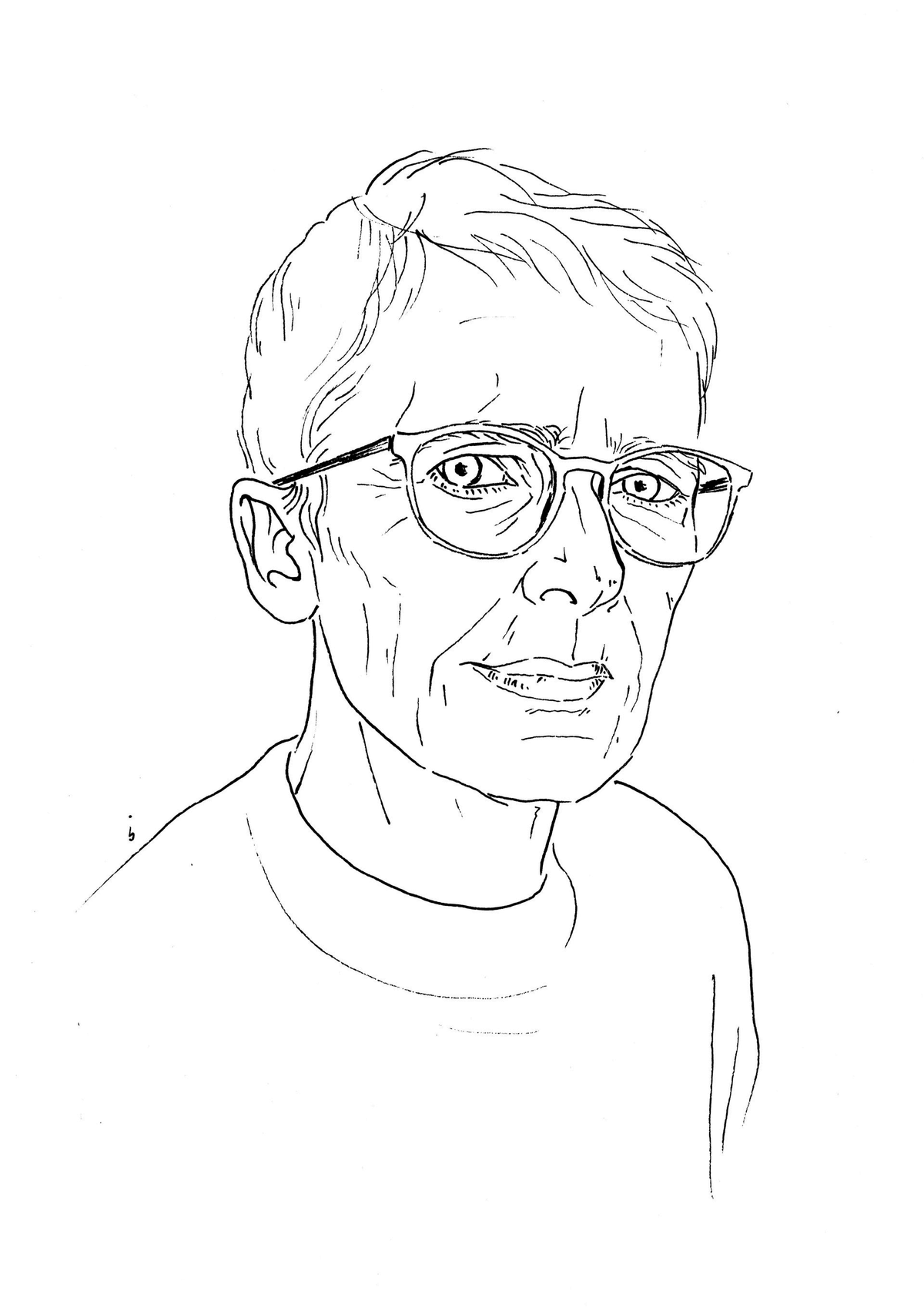Je vous défie de trouver un mot au contenu sémantique plus riche et plus ambigu que celui de “bête”. Au premier abord, notre dictionnaire nous dit qu’elle définit « tout animal, homme excepté ». Cependant, la bête n’est pas l’animal… Alors, à quoi sert bête ? D’où vient-elle ?
En latin, bestia est l’antonyme d’homo, tandis qu’anima inclut tous les êtes animés. L’équivalent grec d’anima est zôon, dont la définition est encore plus large puisqu’il regroupe les animaux, les plantes, les hommes et les dieux… enfin presque, puisque, pour Aristote, l’homme est un zôon qui a certaines spécificités, le logos (parole-pensée) car il utilise la parole pour parfaire sa nature dans la polis (la cité). L’homme est un animal politique (parmi d’autres, comme les abeilles, par exemple pour Platon, même si intervient là encore une nuance toute grecque). Aristote est le premier à s’intéresser aux animaux d’une façon systématique car « il croyait avec Héraclite que “les dieux sont aussi dans la cuisine” et qu’il fallait accepter d’entrer dans la cuisine de la nature si l’on voulait y comprendre quelque chose » (J. L. Labarrière). Précisant au passage « Aussi ne faut-il pas avoir de dégoût, comme les enfants pour l’étude des animaux repoussants. Car dans toutes les œuvres de la nature il y a quelque chose à admirer ». Ce type d’assertion accroît mon scepticisme (et non mon cynisme qui est “propre au chien”) devant l’idée trop largement répandue que nos sociétés modernes sont le fruit d’un progrès ininterrompu.
Là où cela se complique, c’est lorsque cela se simplifie. Si la culture latine comprend l’anima comme la force vitale, peu à peu, avec le temps et le monothéisme, l’anima deviendra l’âme, l’esprit, c’est-à-dire ce qui est strictement propre à l’homme : en un mot, le Moyen Âge sépare définitivement l’animal de l’anima, et c’est alors que la bête fait surface.
Parce que les animaux sont extrêmement présents dans la symbolique chrétienne et l’imaginaire populaire médiéval, on invente le “bestiaire”, un genre littéraire qui connaîtra un fort engouement. Ces ouvrages traitent des “propriétés des animaux” plus que d’observations naturalistes (Aristote s’éloigne). Ce n’est pas la véracité qui prime, mais la symbolique : lions et chiens y côtoient licornes et griffons. On “charge alors la bête” d’une symbolique dont elle aura bien du mal à se défaire (Aristote, pardonne-nous). Cependant, la proximité du monde médiéval avec l’animal laisse à penser que le clivage homme/animal n’est pas aussi marqué qu’on pourrait le penser (lire p. 16). Ce n’est qu’au XIIIe siècle, que la bête va commencer sa descente aux enfers et désigner la partie animale de l’homme, c’est-à-dire la bêtise. Ainsi, LA bête prend la tête des enfers, conduit l’apocalypse, devient l’incarnation du mal définitif, et pourtant… on continue à s’en moquer, à bêtifier, à en faire notre bête noire comme si nous étions restés à l’âge bête.
On se demande aujourd’hui qui doit, de l’homme ou de la bête, revendiquer la bêtise comme étant ce qui le définit le mieux. Avant de répondre, nous vous proposons d’entrer dans la cuisine, celle où les singes communiquent et les geais se souviennent.